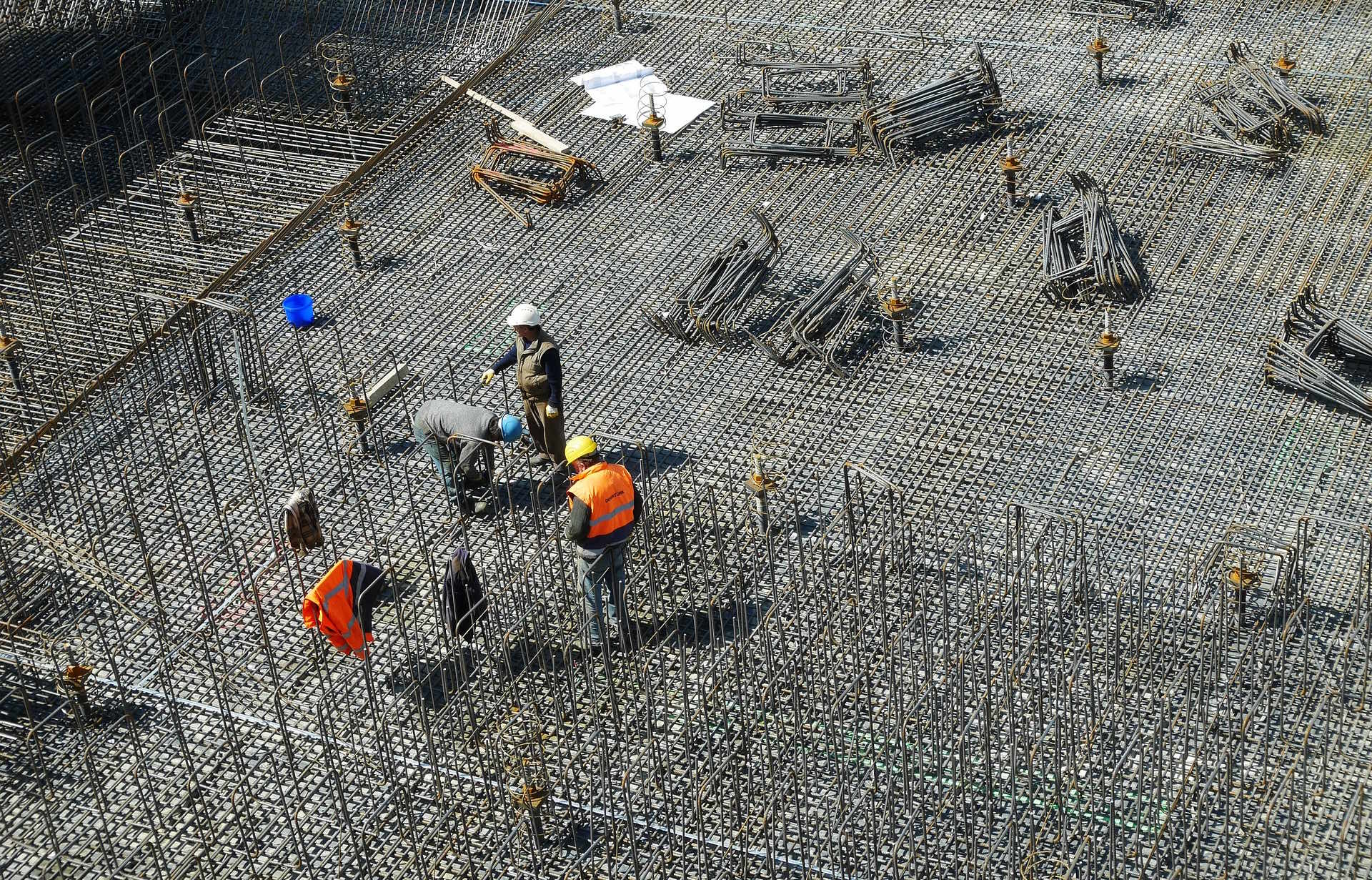Maladies intestinales : symptômes, causes et prise en charge chez les seniors
Les maladies intestinales couvrent un large éventail de troubles qui affectent l'intestin et la qualité de vie, particulièrement chez les personnes âgées. Elles peuvent toucher la motricité, l'absorption des nutriments et la flore intestinale, et se manifester par des douleurs abdominales, des troubles du transit ou une perte d'appétit. Comprendre les signes, les facteurs de risque et les options de prise en charge aide à mieux prévenir et gérer ces affections chez les seniors.

Cet article est à titre informatif uniquement et ne doit pas être considéré comme un avis médical. Veuillez consulter un professionnel de santé qualifié pour des conseils et un traitement personnalisés.
Qu’est-ce que les maladies de l’intestin ?
Les maladies de l’intestin regroupent des affections inflammatoires (comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse), des infections, des troubles fonctionnels (syndrome de l’intestin irritable), des diverticuloses, ainsi que des problèmes liés au microbiote. Chez les seniors, la prévalence de certaines pathologies augmente en raison du vieillissement des tissus, des comorbidités et de la polymédication. Le diagnostic repose sur l’anamnèse, l’examen clinique, des analyses biologiques et parfois l’imagerie ou une endoscopie.
Comment la digestion est-elle perturbée ?
La digestion peut être perturbée à plusieurs niveaux : sécrétion insuffisante d’enzymes, ralentissement du transit, altération de la muqueuse intestinale ou déséquilibre du microbiote. Ces changements entraînent malabsorption, ballonnements, diarrhée ou constipation. Chez les seniors, la digestion devient souvent moins efficace à cause d’une diminution de la motricité intestinale, d’une réduction de la masse musculaire et de modifications du régime alimentaire. Adapter l’alimentation et corriger des carences peut améliorer la digestion et réduire les symptômes.
Constipation : causes et signes chez les seniors
La constipation est fréquente chez les personnes âgées et peut être due à une hydratation insuffisante, une alimentation pauvre en fibres, un manque d’activité physique, certains médicaments (analgésiques, anticholinergiques) ou des troubles métaboliques. Les signes comprennent selles dures, effort excessif à la défécation, sensation de vidange incomplète et douleurs abdominales. Une constipation chronique peut entraîner des complications comme des hémorroïdes ou une impaction fécale. La prévention inclut une alimentation riche en fibres, une hydratation suffisante et un programme d’exercice adapté.
Risques particuliers et prévention pour les personnes âgées
Les personnes âgées présentent des risques accrus de complications : déshydratation, carences nutritionnelles, chutes liées à des épisodes de diarrhée ou de faiblesse, et interactions médicamenteuses. La prévention passe par une évaluation régulière des médicaments, une surveillance du poids et des apports alimentaires, et des bilans biologiques pour dépister les carences en vitamines ou électrolytes. Le suivi médical régulier et l’éducation du patient et de son entourage permettent d’identifier rapidement les signes d’alerte et d’ajuster les traitements.
Quand consulter et quelles prises en charge ?
Il est important de consulter un professionnel de santé si apparaissent des signes d’alarme : saignement rectal, perte de poids involontaire, douleurs abdominales intenses, fièvre persistante ou changement important du transit. La prise en charge peut combiner mesures hygiéno-diététiques (fibres, hydratation, activité physique), traitements médicamenteux (laxatifs à court terme, antidiarrhéiques, antibiotiques si infection), interventions endoscopiques ou chirurgicales selon la cause, et prise en charge nutritionnelle pour corriger les carences. Pour les seniors, l’approche est souvent multidisciplinaire, impliquant médecin généraliste, gastro-entérologue, diététicien et parfois kinésithérapeute.
Conclusion
Les maladies intestinales peuvent avoir un impact important sur la qualité de vie, surtout chez les seniors. Une identification précoce des symptômes, des ajustements alimentaires et un suivi médical adapté réduisent le risque de complications. Les approches de prise en charge varient selon la cause et doivent être personnalisées en tenant compte des comorbidités et des traitements en cours.